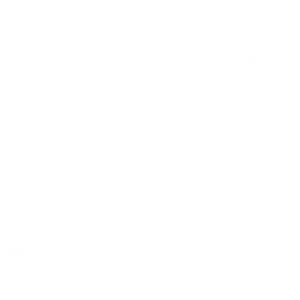Au cœur d’un débat juridico-politique à forte intensité, deux figures majeures de la scène gabonaise s’affrontent autour de l’interprétation de l’article 82 alinéa 3 du Code électoral : Me Francis Nkea Nzigue, avocat et agrégé de droit, et Jean Valentin Leyama, économiste et ancien responsable politique. En jeu : la portée juridique de la création d’un parti politique par un élu indépendant en cours de mandat. Est-ce une simple expression de la liberté d’association ? Ou bien un acte d’adhésion, donc prohibé par la loi ?
La thèse de Me Francis Nkea : distinguer création et adhésion

Selon Me Nkea, « créer un parti n’est pas constitutif de transhumance politique ; c’est l’adhésion à un parti existant qui est visée par la loi ». L’ancien Garde des Sceaux soutient que l’article 82 alinéa 3 interdit aux élus indépendants de rallier un parti politique légalement reconnu pendant la durée de leur mandat, mais ne saurait être interprété comme une interdiction de fonder un nouveau parti. Il invoque, pour cela, la liberté d’association garantie par la Constitution, estimant que cette liberté inclut la possibilité, pour tout citoyen – même élu – de créer une organisation politique.
Jean Valentin Leyama réplique : en droit, créer un parti, c’est déjà y adhérer

À cette lecture, Jean Valentin Leyama oppose un argumentaire strictement fondé sur le droit positif. Dans un commentaire incisif publié sur la page Facebook de Gabon Media Time, l’ancien secrétaire exécutif du parti RÉAGIR démonte le raisonnement de Me Nkea en s’appuyant sur les dispositions combinées de l’article 82 alinéa 3 du Code électoral et de la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n°016/2011 du 14 février 2012.
Selon lui, la procédure de création d’un parti est juridiquement encadrée et requiert des pièces justificatives qui ne peuvent être produites que par des membres adhérents : procès-verbal constitutif, pièces d’identité, casier judiciaire… « On ne peut pas créer un parti sans en être membre. C’est une contradiction en soi », assène-t-il. D’où cette conclusion tranchée : la création implique nécessairement l’adhésion, ce qui expose un élu indépendant à la sanction prévue par la loi – en l’occurrence, l’annulation de son élection.
Liberté d’association : un principe, mais pas une immunité
Le débat dépasse la simple querelle juridique. Il touche à un principe fondamental : la liberté d’association. Me Nkea s’en réclame. Mais pour Leyama, cette liberté, bien que constitutionnelle, n’est pas absolue : elle peut être encadrée lorsqu’elle entre en conflit avec les exigences de la transparence et de la morale publique. L’article 2 du Code électoral fixe le périmètre de son application, notamment aux députés, et c’est dans ce cadre, affirme-t-il, que l’interprétation doit se faire.
La question devient alors politique autant que juridique : est-il légitime, pour un élu indépendant, d’exploiter une brèche légale pour contourner l’interdiction de transhumance, en se contentant de « créer » un parti plutôt que de rejoindre un parti existant ? Pour Leyama, la réponse est non : « Ce serait un contournement manifeste de l’esprit de la loi ».
Une clarification attendue : jurisprudence ou décision administrative ?
Le différend ne se limite pas à une opposition d’analystes. Il pourrait bien devenir un cas d’école devant la Cour constitutionnelle, ou trouver un règlement en amont, par une décision du ministère de l’Intérieur, chargé d’enregistrer les partis politiques. Celui-ci pourrait refuser tout dossier de création émanant d’un élu indépendant en exercice, estimant qu’il contrevient à l’article 82.
Quoi qu’il en soit, comme le résume Jean Valentin Leyama :
« En droit gabonais, la création d’un parti est un acte d’adhésion. Et pour un élu indépendant, cela suffit à annuler le mandat. »
Ce débat souligne une tension persistante entre liberté politique individuelle et exigences de moralisation de la vie publique, dans un contexte où le législateur a explicitement voulu verrouiller les pratiques de transhumance. La manière dont les institutions trancheront cette question dira beaucoup sur leur volonté réelle d’imposer une rigueur éthique à la vie politique gabonaise.